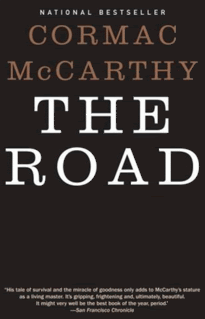
Vintage International, 2006, 287 p.
On en a entendu parler de tout bord tout côté (pour peu qu'on s'intéresse aux livres, soit), il a valu à son auteur le Pulitzer, et même de faire partie du prestigieux Oprah's Book Club, c'est pas rien. Y'a des auteurs moins sauvages que McCarthy qui ont refusé cet honneur, mais lui l'a accepté. Même qu'il a bien voulu s'asseoir avec elle pour accorder une entrevue, chose qu'il n'avait pas faite depuis très longtemps, et c'est pas parce qu'il n'a pas eu d'invitations.
Il fait bon, des fois, de voir des best-sellers qui sont de bons livres pour vrai.
Cormac McCarthy est sans aucun doute un écrivain mythique. Après avoir donné les classiques de l'ouest américain que sont De si jolis chevaux (titre très gai, j'en conviens, l'original est All The Pretty Horses) et Méridien de Sang, ou le rougeoiement du soir dans l'ouest (beaucoup mieux, le titre), où l'auteur assommait son lecteur de phrases interminables et lourdes, refusant toute ponctuation et préférant écrire « et » plutôt que de placer une virgule, McCarthy s'est mérité une réputation d'auteur difficile. Essentiel, mais difficile, et on a pas encore parlé de la dureté de ses sujets.
Nous l'avons vu revenir dans l'actualité littéraire dernièrement avec son roman No Country for Old Men, magistralement adapté au cinéma par les frères Cohen. Et presque en même temps (m'a-t-il semblé) paraissait The Road. Deux romans marquants par leur concision et leur économie de moyens. Le monsieur se fait vieux et a fini par se tanner des feux d'artifices.
Pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, l'histoire est très simple. Un homme et son fils qui suivent la route qui les mène vers le sud du pays, alors que la terre n'est plus qu'un vaste cendrier, le soleil un concept vague, et la fraternité définitivement chose du passé.
Nous ne savons rien de ce qui a pu causer ainsi la fin du monde tel que nous le connaissons. Dieu merci. Plutôt que de trouver une cause à l'apocalypse, ce qui nous intéresse ici, c'est le père et le fils en situation de survie. Le fils n'a jamais connu le monde d'avant. La mère, elle, est partie assez tôt. (Je ne me rappelle plus si elle s'est suicidée ou si elle a simplement quitté. Il me semble que c'était vague). Ainsi, père et fils avancent sur la route et reprennent le chemin chaque jour avec les mêmes idées en tête. Manger, trouver refuge, faire un feu, se protéger.
En soi, la trame du livre est assez répétitive. Quelques personnages secondaires surviennent, mais très peu. La même histoire revient sensiblement chaque jour, mais le lecteur reste tout de même collé au livre qui, sans divisions de chapitres, mais écrit en de très courts paragraphes, est pratiquement impossible à lâcher. Grand bien nous fasse, parce que lire un livre comme ça pendant deux semaines, ça commencerait à être un peu déprimant.
Toute cette histoire d'apocalypse est secondaire, n'est en fait qu'un prétexte pour décrire une relation des plus touchantes entre le père et le fils. Loin d'être une histoire larmoyante à haute teneur en émotion (comme si c'était un vrai best-seller), la relation nous est décrite avec une économie remarquable de moyens, au travers de dialogues simples et brefs.
Can we wait a while?
Okay. But it's getting dark.
I know.
Okay.
They sat on the steps and looked out over the country.
There's no one here, the man said.
Okay.
Are you still scared?
Yes.
We're okay.
Okay.
Aussi insignifiant ce dialogue puisse-t-il avoir l'air, c'est à la longue, au fil des pages que ces échanges viennent à nous posséder et nous envoûter. La patience du père et son instinct de protection, la vivacité du fils et son incompréhension de la violence, deux humains à qui l'autre est tout ce qui reste. Et malgré toute cette désolation, McCarthy nous montre que l'humain naît fondamentalement bon. Même s'il n'a jamais connu le monde d'avant, le fils ne peut se résoudre à des actes de violence ou de méfiance, éléments maintenant nécessaires à la survie. Ce sont là des réflexes du père, qui devra tuer d'autres humains devant son fils tout en lui rappelant que ce sont eux les gentils.
J'ai lu The Road en anglais, en me disant que je n'aurais pas de difficulté devant ce texte aéré et concis. Bon. J'en ai manqué quelques bouts (voire l'histoire de la mère, plus haut), surtout question de vocabulaire. Hélas, je ne suis pas du genre à fouiller dans le dictionnaire quand je ne comprend pas un mot. Si j'avais fait ça, ça m'aurait pris trois semaines à lire ce livre et j'en viendrais à croire que la fin du monde est bel et bien arrivée.
(Originalement publié le 21 mai 2008)

1 commentaire:
j'ai aussi adoré.
mais j'ai très peur du film qui s'en vient.
on verra.
moi, je l'ai lu sur 3 semaines...
vaut mieux le lire rapidement, parce que la répétition devient un peu lourde à la longue...
connais-tu david foster wallace ?
Enregistrer un commentaire